Entretien
Entretien entre Cédric Mong-Hy et Mounir Allaoui, dans le cadre de la Biennale Arts Actuels, Le Port, La Réunion.
2011
Cédric Mong-Hy : Est-ce que tu peux nous parler du film que tu es en train de préparer pour la Biennale ?
Mounir Allaoui : J’ai toujours été intéressé par le fait de filmer quelqu’un au quotidien. Filmer une personne, sans chercher à créer une esthétique … Ce que j’ai tenté de faire, c’est de réduire l’intention artistique au minimum. J’ai demandé à une étudiante de l’École des Beaux-Arts de La Réunion, Mélanie Francœur, si je pouvais la filmer en train de travailler, de prendre des photos. Elle m’a donné son accord et nous avons commencé à nous donner des rendez-vous. Petit à petit, nous nous sommes vus en dehors des séances de photos qu’elle programmait : nous nous sommes rencontrés en ville, au musée, chez des amis… et je la filmais. Nous fixions nos rendez-vous sur Facebook, et pour davantage construire mon film, j’ai décidé d’intégrer, entre les différentes séquences du film, ces conversations électroniques qui mènent à la rencontre. Je laisse ainsi transparaître nos discussions. Par exemple, lorsque mon modèle m’interpelle, je lui réponds de derrière la caméra et cela fait partie du film. J’ai voulu travailler de manière à ne pas créer de situation. Forcément, il y a une esthétique, puisque je cadre, je monte. Mais je tente de rester très brut et de garder le rythme de vie, sans donner l’impression que je cherche à créer un dispositif. On rentre un peu dans le documentaire, mais ce qui ressort, c’est la relation entre le modèle et celui qui la filme.
C. M. : Est-ce que ce n’est pas une forme savante de voyeurisme ?
M. A. : Ce n’est pas du tout du voyeurisme, ou du moins, ce n’est pas plus voyeuriste que n’importe quelle autre scène filmée, et je casse le thème du voyeurisme à la base en faisant de mon personnage quelqu’un qui participe et qui prend des photos. Au départ, on voit Mélanie prendre des images, mais généralement, je ne filme pas ce qu’elle photographie, même si dans certaines situations, on la voit en train de regarder ses prises de vues dans le petit écran digital de son appareil photo. Je ne suis donc pas vraiment dans le voyeurisme, en tout cas ce n’est pas mon thème, puisque je suis en train de filmer une personne qui est dans le même acte que le mien. Il arrive aussi que mon modèle se tourne vers moi et me prenne en photo. Il y a donc un échange. Du fait que je fasse de mon personnage quelqu’un qui regarde, je n’en fais pas qu’un sujet de voyeurisme. Il est clair cependant que cela peut se rapprocher d’une esthétique assez récente qui est née avec la télé-réalité : ce désir de saisir les choses d’une manière brute. D’autant plus qu’avec les nouvelles caméras, le cinéma s’est démocratisé, ce n’est plus vraiment coûteux de réaliser un documentaire par exemple. Pour moi, l’important est de complètement désacraliser l’image et de faire apparaître au minimum le geste, l’intention artistique. Même si c’est assez illusoire …

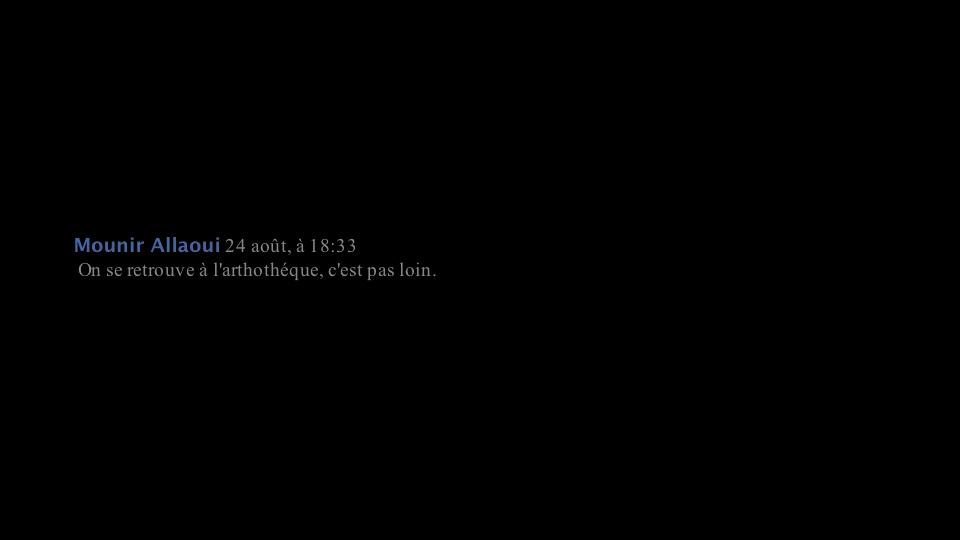
C. M. : Est-ce que ce film a un rapport avec le travail que tu as fait récemment sur les récoltes de contes comoriens, où précisément nous avons affaire à une parole sacrée ?
M. A. : J’ai souvent évité de créer des situations. Quand je suis arrivé pour filmer ces récits de contes qui allaient mener à la réalisation d’une vidéo que j’ai intitulée Mhaza Kungumanga, j’étais avec une amie japonaise. Nous étions donc sur le même lieu, mais pour deux projets différents. J’ai fait en sorte que l’attention des conteurs ne soit pas dirigée vers la caméra. Natsuki Kawasaki, mon amie, était là pour récolter ces contes qu’elle a publiés chez un éditeur japonais. C’est elle qui attirait l’attention, qui enregistrait le son et qui récoltait la parole. Et moi j’étais là, désaxé, et je filmais cette situation où Natsuki récoltait les contes.
C. M. : Tu es un tiers, c’est comme si tu n’étais pas là.
M. A. : Je fonctionne essentiellement comme cela. Dans beaucoup de mes travaux, je tente de me faire oublier. Par exemple, quand je suis allé filmer les réfugiés de l’archipel des Chagos, pour une vidéo intitulée Hors/Diego Garcia, la situation était déjà là, elle avait été générée par l’École des Beaux-Arts de La Réunion et par le collectif des habitants des Chagos, qui avaient décidé de travailler ensemble. J’ai alors filmé, en retrait, des gens qui parlaient et racontaient leurs vies aux intervieweurs.

C. M. : Tu es d’origine comorienne, tu es un admirateur du cinéma de Jean-Luc Godard, tu es fortement attiré par l’Asie, particulièrement par la Chine et le Japon, et tu vis et travailles à La Réunion. D’où vient ta façon de travailler ? De toutes ces influences en même temps ?
M. A. : Quand j’étais étudiant aux Beaux-Arts de La Réunion, j’avais déjà un objectif assez fixe : je voulais faire de la vidéo comme on fait du cinéma, c’est-à-dire que je ne voulais pas tout à fait faire de la vidéo, mais produire des images vidéos qui ressemblent à des images cinématographiques. J’ai donc rarement été dans l’installation, j’ai rarement pensé mon travail comme adapté à un espace d’exposition d’art contemporain : je l’ai toujours pensé au travers d’un dispositif de projection cinématographique. Mon travail se regarde du début à la fin, c’est une narration. C’est très important pour moi, parce que dans un espace d’exposition classique, comme une galerie d’art, les vidéos passent généralement en boucle et il est rare qu’alors le spectateur arrive au début et parte à la fin du film. À mon avis, dans ce type d’espace, mes vidéos sont regardées très superficiellement, d’autant plus que l’obscurité de la salle de cinéma est absente, ce qui empêche l’immersion. Quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j’étais déjà très intéressé par le cinéma et j’avais des idées assez établies. Je me suis tout de suite dirigé vers la vidéo, mais j’ai aussi découvert beaucoup de choses et cela m’a permis d’enrichir mon esthétique.
C. M. : D’où vient cette esthétique pour sa plus grande part ? Car, dans tes films, on sent diverses influences, celle des gros plans d’Eisenstein, celle de Godard, celle des estampes d’Hokusaï …
M. A. : Je dirais qu’en dehors du cinéma, il y a des formes qui m’ont beaucoup marqué et que j’ai utilisées très consciemment. Dans mes premières vidéos, je pensais beaucoup aux haïkus et aux compositions des estampes japonaises…
C. M. : … tu voulais faire des haïkus visuels…
M. A. : … voilà, des haïkus visuels, et des images composées à la manière des estampes.
C. M. : C’est un métissage que tu as intégré très volontairement.
M. A. : Au fur et à mesure, je m’en suis éloigné, mais à mes débuts, cette influence de la poésie japonaise était directe. Ensuite, j’ai découvert un concept japonais, le mononoaware, qui traverse toute l’histoire de l’art japonais, de la littérature à la peinture. On peut dire que le mononoaware, c’est la rencontre d’un moment, d’un paysage souvent éphémère, et de l’esprit humain. L’exemple le plus populaire, c’est l’esthétisation à l’extrême de la chute des sakura, les fleurs de cerisiers. Ce que j’ai tenté d’atteindre, c’est cet esprit très traditionnel, traditionnel en Asie, traditionnel dans des arts autres que le cinéma. Généralement, on ne classe pas mes films dans une forme traditionnelle de vidéo ou de cinéma, mais pour ma part, lorsque je pense mon travail, je me place dans la lignée d’une longue tradition plutôt que dans celle de l’avant-garde. Je n’ai jamais eu l’impression d’être en rupture avec quoi que ce soit. Et la tradition qui m’a ainsi le plus marqué, c’est la tradition extrême-orientale, qu’elle soit chinoise ou japonaise, la seconde étant liée à la première …
C. M. : … Et la tradition chinoise étant liée à la tradition indienne …
M. A. : … Oui, à partir des pensées bouddhistes … Mon ambition serait de m’inscrire dans cette tradition plusieurs fois millénaire.